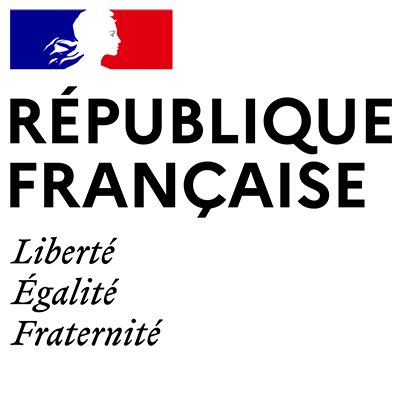Programme Base de Données d’Analyses de Terre (BDAT), financé par le Gis Sol, coordonné par l’Unité Info&Sols de INRAE
L’unité Info&Sols, située 2163 avenue de la pomme de pin, CS 40001 – Ardon, 45075 Orléans CEDEX 2, sous tutelle de INRAE, coordonne un programme s’inscrivant dans la durée sur le suivi de la qualité des sols de France. Ce programme vise à répondre à des problématiques liées à la production agricole ou à la préservation de l’environnement. Son objectif est de participer à l’amélioration de la connaissance sur les propriétés des sols et de leur évolution spatio-temporelle dans le cadre du suivi de la qualité des sols de France métropolitaine. Ce programme est financé par le Groupement d’Intérêt Scientifique sur les Sols, Gis Sol.
Dans ce cadre, des analyses de terre réalisées à la demande d’agriculteurs par des laboratoires d’analyses de sol agréés par le ministère en charge de l’agriculture sont recueillies et analysées sur la base légale de l’exécution d’une mission d’intérêt public et à des fins de recherche scientifique.
Si vous êtes agriculteur et avez demandé des analyses de terre à un laboratoire agréé depuis 1990, ces analyses ont peut-être été fournies par ce laboratoire à l’unité Info&Sols dans le cadre de ce programme.
L’utilité des données récoltées pour atteindre les objectifs de ce programme : les analyses de sol réalisées par les laboratoires d’analyse de sol en France sont d’environ 250 000/an. Le nombre important d’analyses recueillies permet d’atteindre une représentativité statistique suffisante à l’échelle cantonale et sur un pas de temps de 5 ans. Les données personnelles directement identifiantes recueillies par le laboratoire d’analyses de sol lors de la demande d’analyse réalisée par l’agriculteur ne sont pas fournies à l’unité Info&Sols. Seule la commune où se situe la parcelle agricole dans laquelle le sol a été prélevé est fournie pour permettre la géolocalisation de l’analyse. Les analyses ainsi recueillies sont utilisées pour réaliser des statistiques à différents niveaux d’agrégation (canton, petite région agricole, département, région) et seules ces données statistiques garantissant l’anonymat des agriculteurs et le respect du secret statistique sont consultables sur le site du Gis Sol https://webapps.gissol.fr/geosol/.
Les analyses de sol collectées sont utilisées par l’unité Info&Sols pour l’objectif du programme indiqué ci-dessus et ne peuvent être communiquées qu’aux destinataires suivants : l’UMR SAS de INRAE-Institut Agro-AgroCampusOuest pour le contrôle de la qualité des données au regard de l’objectif du projet.
Aucun transfert de données hors de l’Union européenne n’est réalisé.
Ces informations seront conservées, dans les meilleures conditions de sécurité et de confidentialité, sans limite de durée du fait de l’intérêt historique et scientifique du suivi de la qualité des sols de France métropolitaine.
Conformément au Règlement européen relatif à la protection des données personnelles et à la loi Informatique et Libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de limitation. Les analyses de sols ainsi recueillies lors de ce programme pourront faire l’objet d’un projet de recherche scientifique ultérieur à finalité similaire de recherche par l’unité et dans les mêmes conditions de confidentialité et de sécurité.
Si vous souhaitez exercer ces droits et/ou obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser en premier lieu au laboratoire d’analyses de sol auquel vous avez fait une demande d’analyse car il est le seul à savoir si votre analyse a été transférée à l’unité Info&Sols. Vous pouvez vous adresser au Délégué à la protection des données personnelles (DPO) du laboratoire d’analyse. En second lieu, sur la base de votre commune, vous pouvez vous adresser à l’unité Info&Sols, via rgpd-infosol@inrae.fr, Vous pouvez également vous adresser au DPO d’INRAE (cf. ci-dessous).
Si vous estimez, après avoir contacté le laboratoire d’analyse ou l’unité Info&Sols, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL par courrier postal : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07 ou en ligne https://www.cnil.fr/
L’unité se fait accompagner par le Délégué à la protection des données personnelles (DPO) de son établissement de tutelle. Ses coordonnées sont : 24, Chemin de Borde Rouge – Auzeville- CS 52627 ; 31326 Castanet Tolosan Cedex ; France Tél. : +33 1 (0)5 61 28 54 37 ; Courriel : cil-dpo@inrae.fr
Un webinaire sur les 20 ans du Réseau de Mesures de la Qualité des Sols (RMQS) a été présenté en mai 2020 par Claudy Jolivet, Chef de projet du RMQS à INRAE Orléans et est disponible au visionnage sur le site de l’Association Française pour l’Etude des Sols (AFES).
Certains Référentiels Régionaux Pédologiques ne sont pas diffusés par le Gis Sol. Vous en trouverez la liste ci-dessous.
Départements où le Référentiel Régional Pédologique est disponible avec les métadonnées au format INSPIRE
| Départements | Site web |
| Dordogne, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques | Pigma |
| Corrèze, Creuse, Haute-Vienne | Sigena |
| Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan | GéoSAS |
| Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales | OPenIG |
| Eure, Seine-Maritime | GéoNormandie |
| Bas-Rhin, Haut-Rhin | GéoGrandEst |
Départements où le Référentiel Régional Pédologique est disponible sans les métadonnées au format INSPIRE
| Départements | Site web |
| Ariège, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées | Obs-Mip |
| Tarn | CDA Tarn |
| Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne | Sols de Bourgogne |
| Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie | CRA Rhône Alpes |
| Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges | CRA Grand Est |
A l’occasion des 20 ans du Gis Sol, trois événements ont été organisés :
Un concours de création d’outils numériques pour améliorer la diffusion des données disponibles sur les sols et pour enrichir le patrimoine de données en faisant appel aux sciences participatives.
Une enquête auprès des utilisateurs de données sur les sols en France pour mieux connaître leurs besoins en matière de types de données sur les sols, d’échelles de travail, de thématiques étudiées, etc.
Une journée « Les 20 ans du GIS Sol » le 6 décembre 2021 qui a montré les actions conduites par le GIS Sol depuis sa création en 2001 et notamment, l’offre actuelle d’informations sur les sols.
A l’occasion de ses 20 ans, le Groupement d’intérêt scientifique sur les Sols (Gis Sol) organise un concours de création d’outils numériques pour améliorer la diffusion des données disponibles sur les sols d’une part, et pour enrichir le patrimoine de données en faisant appel aux sciences participatives d’autre part.
Les candidats seront invités à relever un des 4 défis proposés.
Défi n°1 : Mieux connaître les sols près de chez moi
Défi n°2 : Rejoindre les observateurs des sols (sciences participatives)
Défi n°3 : Visualiser les sols de France en 3D
Défi n°4 : Partager les données sols dans les jeux de stratégie
Le concours est ouvert à tous. Les participants peuvent y concourir individuellement ou en équipe. La participation au concours est conditionnée par une inscription préalable avant le 15 novembre 2021. En cas d’équipe, une seule inscription est nécessaire. Les trois meilleurs projets seront récompensés.
Déroulé du concours
- Période d’inscription : du 21 juin 2021 au 31 janvier 2022
- Lancement officiel du concours : 6 décembre 2021 à l’occasion de la journée des 20 ans du GIS Sol
- Conception des projets : du 7 décembre 2021 au 2 mai 2022
- Analyse des projets et audition : mai 2022
- Remise des prix : juin 2022
Accéder au règlement du concours
Vidéo de présentation des données du Gis Sol
Diaporama de présentation du concours
Le GIS Sol a souhaité mieux connaître les utilisateurs de données sur les sols en France, ainsi que leurs besoins en matière de types de données sur les sols, d’échelles de travail, de thématiques étudiées, etc.
Que vous soyez utilisateurs confirmés, débutants ou simplement intéressés par les sols, votre avis nous est précieux.
Vos propositions contribueront à améliorer le système d’information sur les sols de France, en mettant notamment en adéquation les services proposés par le GIS Sol avec les besoins que vous avez exprimés pour mener à bien vos projets.
Une première restitution des résultats de cette enquête a été faite lors de la journée « Les 20 ans du GIS Sol » le 6 décembre 2021.
Le rapport complet sur les résultats de l’enquête est disponible sur le portail HAL.
6 DÉCEMBRE 2021
Le 6 décembre 2021, le Groupement d’intérêt scientifique sur les sols (Gis Sol) a fêté ses 20 ans par un événement montrant les actions qu’il a conduites depuis sa création en 2001 et notamment, l’offre actuelle d’informations sur les sols. Ce fût également l’occasion de recueillir les attentes des utilisateurs sur les sols, compartiment clé de l’environnement, dont la gestion raisonnée des usages est de plus en plus reconnue pour le maintien des activités agricoles (alimentaires et non alimentaires), l’aménagement du territoire, la préservation de la biodiversité ou encore l’adaptation et l’atténuation du changement climatique.
Cette journée s’est tenue en distanciel le 6 décembre 2021.
Le programme définitif de la journée :
9h00-9h30 : accueil des participants
9h30-9h40 : ouverture de la journée
Discours de la ministre de la Transition écologique : vidéo
Discours du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation vidéo
9h40-10h00 : l’histoire du GIS Sol : étapes marquantes : vidéo, diaporama C. Gascuel (INRAE)
10h00-10h20 : restitution des résultats de l’enquête sur les besoins en données et informations sur les sols par les utilisateurs : vidéo, diaporama P. Laville (ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation)
10h20-12h15 : l’offre actuelle du GIS Sol et son appui aux politiques publiques
Offres en support des politiques pour le climat : vidéo, diaporama M. Martin (INRAE), diaporama A. Duparque (Agro-Transfert Ressources et Territoires)
Offres en support des politiques pour la santé : vidéo, diaporama H. Roussel (ADEME) , diaporama A. Pelfrene (JUNIA)
Offres en support des politiques pour la biodiversité des sols : vidéo, diaporama A. Lévêque (OFB), diaporama M. Valé (Auréa AgroSciences)
Offres en support des politiques d’aménagement du territoire : vidéo, diaporama J.-F. Brunet (BRGM), diaporama P. Branchu (Cerema)
12h15-12h30 : grand témoin – intégration du dispositif national dans l’observatoire des sols de l’Union européenne : vidéo, diaporama L. Montanarella (EC Joint Research Centre)
12h30-14h00 : pause déjeuner
14h00-14h25 : propriétés et indicateurs de fonction des sols, quels nouveaux besoins : vidéo, diaporama T. Caquet INRAE)
14h25-15h45 : table ronde : Questions/besoins des acteurs par des collectivités, coopératives, agriculteurs : vidéo, diaporama table ronde
15h45-16h00 : pause
16h00-16h30 : présentation du concours sur les données sols : vidéo, diaporama I. Joassard (ministère de la Transition écologique)
16h30-16h45 : ouverture des données au service des politiques publiques : vidéo
16h45-17h00 : grand témoin – vision de l’organisation nationale par un acteur institutionnel européen : vidéo, vidéo des questions, diaporama R. Baritz (EEA)
17h00-17h30 : conclusion des co-présidents du Gis Sol : vidéo
Un inventaire de la nature des sols et de leur distribution spatiale : le programme IGCS (Inventaire, Gestion et conservation des sols) vise à identifier, définir et localiser les principaux types de sols d’une région ou d’un territoire, et à caractériser leurs propriétés présentant un intérêt pour l’agriculture et pour l’environnement. En élaborant des documents cartographiques associés à des bases de données, les partenaires du programme IGCS permettent ainsi d’évaluer l’aptitude des sols à différents usages et d’en préciser les risques pour faciliter les prises de décisions des gestionnaires locaux.
Pour répondre à de nombreux enjeux des territoires : Quels sont les risques d’érosion pour une région donnée ? Où planter des noyers à bois ? Où recycler les déchets urbains ? Où implanter le contournement d’une commune ? Comment optimiser l’irrigation avec des ressources en eau limitées ? Autant de questions variées qui intéressent concrètement les gestionnaires des territoires ruraux et de leurs ressources. Seules des informations précises sur les propriétés des sols et leur localisation permettent d’y répondre. Les données produites et capitalisées dans le cadre d’IGCS sont ainsi déjà utilisées par de nombreuses administrations ou organismes (ministères, services déconcentrés, collectivités territoriales, organismes agricoles, organismes d’aménagements, bureaux d’études, agences de bassins, …). Il existe aujourd’hui un besoin fort de développer les échelles fines, en particulier pour les questions d’aménagement du territoire.
Trois principales échelles spatiales :
les « Secteurs de Référence » (SR) sont des cartographies détaillées de territoires avec des échelles inférieures au 1/50 000ème. Elles permettent de traiter des questions agricoles ou environnementales avec une bonne précision à l’échelle locale : irrigation, drainage, aptitudes à l’épandage, adaptation des cépages aux terroirs… L’acquisition de références techniques sur les types de sol représentatifs d’une petite région naturelle permet de formuler des recommandations adaptées. Elles permettent ainsi d’acquérir des références généralisables à des systèmes sol analogues.
Les inventaires « Connaissance Pédologique de la France » (CPF) correspondent à des bases de données acquises à des échelles moyennes de type 1/50 000ème à 1/100 000ème. Leur objectif est d’établir les lois de répartition des sols sur la base de leurs facteurs de formation : le matériau géologique, la géomorphologie, le climat, la végétation et les actions anthropiques.
Les « Référentiel Régional Pédologique » (RRP) sont des bases de données géographiques régionales dont la précision correspond au minimum à celle d’une représentation cartographique à 1/250 000ème. L’objectif principal des RRP est de répondre aux besoins de gestion et d’aménagement des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et des administrations, à des échelles départementale ou régionale. Ce volet est aujourd’hui prioritaire en vue d’obtenir une carte harmonisée sur l’ensemble du territoire à l’horizon 2016.
De nombreux partenaires mobilisés : le programme IGCS est mené en collaboration avec de très nombreux partenaires régionaux ou départementaux. Ils produisent des bases de données au format DoneSol, selon la norme AFNOR NF X31-560, relative à l’acquisition et à la gestion informatique de données pédologiques en cartographie des sols. Des procédures de vérification de la cohérence des données sont ensuite mises en œuvre et aboutissent, pour les RRP, à l’attribution d’un niveau de qualité par le ministère en charge de l’Agriculture, en fonction de la précision et de quantité de l’information contenue dans la base de données.
Retrouvez l’ensemble des productions IGCS grâce à l’outil Refersols.
Le Réseau de Mesures de la Qualité des Sols : un outil de surveillance des sols à long terme
Les sols évoluent constamment sous l’effet de grands facteurs naturels et sous l’effet des activités humaines (usages, aménagements fonciers, pratiques agricoles, épandages de boues, retombées atmosphériques, pollutions accidentelles, …). Ces évolutions d’origine anthropique sont, la plupart du temps, préjudiciables au maintien de la qualité des sols. Elles sont le résultat de processus longs et cumulatifs, difficilement détectables et dont certains sont parfois irréversibles à l’échelle de temps humaine. Le maintien de la qualité des sols rend indispensable de détecter de façon précoce l’apparition et les tendances de ces évolutions, à l’aide de programmes d’observation et de suivi de la qualité des sols. Depuis l’an 2000, le Réseau de Mesures de la Qualité des Sols (RMQS) répond à ces objectifs d’évaluation et de suivi à long terme de la qualité des sols de France.
Deux mille deux cent quarante sites échantillonnés tous les quinze ans
Le réseau RMQS repose sur le suivi de 2240 sites répartis uniformément sur le territoire français (métropole et outre-mer), selon une maille carrée de 16 km de côté. Des prélèvements d’échantillons de sols, des mesures et des observations sont effectués tous les quinze ans au centre de chaque maille. L’ensemble des opérations réalisées sur un site est détaillé dans le Manuel du Réseau de Mesures de la Qualité des Sols. La première campagne de prélèvement en métropole (RMQS1) s’est déroulée de 2000 à 2009 et a permis la mise en place de 2170 sites. La deuxième campagne métropolitaine (RMQS2) se déroulera de 2016 à 2027. Le RMQS couvre également les départements d’Outre-mer avec 70 sites répartis aux Antilles, à la Réunion, à Mayotte et en Guyane.
Contamination, changement climatique et biodiversité
L’évaluation et le suivi de la qualité des sols sont fondés sur l’analyse de propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols, associée à la recherche des sources de contamination diffuse et à la connaissance de l’historique de l’occupation et des pratiques de gestion de chaque site. La première campagne RMQS, axée sur la contamination des sols, a permis de cartographier les teneurs en 9 éléments traces métalliques (ETM) : cadmium, cobalt, chrome, cuivre, molybdène, nickel, plomb, thallium, zinc. Grâce aux échantillons archivés par le conservatoire des sols, l’analyse des échantillons s’est poursuivie par la mesure d’autres contaminants minéraux (As, Hg) et organiques (HAP, PCB, dioxines et furanes). Les données du RMQS ont permis de réévaluer avec précision les stocks de carbone des sols et de cartographier la biomasse microbienne des sols. Ces paramètres seront reconduits durant la nouvelle campagne afin de mesurer l’évolution des sols entre les deux campagnes. De nouveaux paramètres ont été ajoutés afin de mieux évaluer la sensibilité des sols en contexte de changement climatique (réserve utile, matières organiques particulaires, stocks de carbone profonds). Des perspectives d’adosser au RMQS un programme de phytopharmacovigilance dans les sols et un réseau de surveillance de la biodiversité du sol (faune, flore, microorganismes bactériens et fongiques) sont à l’étude.
Connaître la variabilité des horizons de surface des sols cultivés
Environ 250 000 analyses de terre sont réalisées chaque année en France. Elles sont majoritairement demandées par les agriculteurs pour gérer au mieux la fertilisation. Par leur nombre et la diversité d’origine des échantillons, ces analyses de terre constituent une source d’information intéressante et originale sur la variabilité des horizons de surface des sols cultivés. Regrouper les résultats de ces analyses en base de données permet le suivi des évolutions à la fois spatial et temporel des propriétés physico-chimiques des sols (pouvant parfois être influencées par l’activité anthropique) et fourni une information complémentaire aux informations cartographiques issues des programmes d’inventaire.
Avec la collaboration de laboratoires d’analyses de terre agréés par le ministère chargé de l’Agriculture, le Gis Sol met à disposition des résultats agrégés, issus du traitement des analyses de la BDAT (base de données des analyses de terre), soit plus de 2 millions d’échantillons d’horizons de surface de sols cultivés, prélevés en France entre 1990 et 2014. Ce sont ainsi plus de 26 millions de résultats d’analyses qui sont regroupées dans la base de données.
Les données et leur accessibilité
La BDAT regroupe au total 31 paramètres permettant d’évaluer les propriétés physico-chimiques des sols (pH, carbone, capacité d’échange cationique, taux de saturation), leur fertilité (azote, carbone organique, phosphore, potassium, magnésium, sodium), leurs teneurs en métaux et métalloïdes (bore, cuivre, fer, manganèse, zinc) et enfin, leur texture (argile, limon, sable).
Les données statistiques agrégées par canton, sont disponibles pour 5 périodes : 1990-1994, 1995-1999, 2000-2004, 2005-2009, 2010-2014. La répartition des résultats d’analyses est hétérogène sur le territoire métropolitain : à l’inverse des régions de montagnes, les grandes régions céréalières sont bien pourvues.
Une base de données géographique et temporelle
Pour respecter la confidentialité des données individuelles collectées, les analyses collectées dans la BDAT et géoréférencées à la commune sont agrégées au niveau cantonal. Avec des données collectées sur 25 ans, la BDAT permet d’étudier les éventuelles évolutions des propriétés physico-chimiques des sols.
La BDAT constitue un outil pertinent pour étudier à moyenne échelle des thématiques pédologiques, agronomiques ou environnementales impliquant l’horizon de surface des sols.
Cette base de données peut par exemple, alerter sur l’évolution de caractéristiques agronomiques des sols agricoles comme la diminution des teneurs en carbone organique des sols en Franche-Comté entre 1990 et 2004. Cette tendance est plus forte en plaine à l’Ouest de la région, qu’en montagne à l’Est. Or, le carbone organique est un important composant du sol tant du point de vue agricole qu’environnemental.
Des analyses des teneurs en éléments traces métalliques (ETM) réglementaires sur les terrains recevant des boues de station d’épuration urbaine : conformément aux prescriptions du décret du 8 décembre 1997 complété par l’arrêté du 8 janvier 1998, les teneurs en sept éléments traces métalliques (ETM) sont déterminées (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) sur des échantillons de sols prélevés en surface (horizons labourés) des terrains agricoles susceptibles de recevoir des épandages de boues de station d’épuration urbaine.
Plus de 73500 analyses regroupées dans une base de données : deux collectes nationales, initiées par l’ADEME et réalisées par l’Inra en 1998 et en 2009, ont permis de rassembler des résultats d’analyses en éléments traces métalliques et parfois des analyses de caractérisation agropédologique réalisées sur les mêmes échantillons. Outre ces données numériques, des informations complémentaires ont été recherchées. Les unes relatives aux sites prélevés, telles que le nom de la commune, les coordonnées géographiques précises du lieu de prélèvement, l’organisme ayant réalisé l’étude préalable à l’épandage. Les autres relatives aux analyses elles-mêmes, telles que la méthode de mise en solution utilisée avant dosage des ETM, l’identité du laboratoire ayant réalisé les analyses, leur date, etc. La répartition des sites n’est pas homogène sur le territoire, traduisant le caractère non supervisé de l’échantillonnage. Étant donné l’origine des analyses (très majoritairement des plans d’épandages de boues d’épuration), le jeu de données comporte principalement des sols agricoles (très peu de sols sous prairies, pas de sols forestiers, d’alpages ou sous végétation spontanée) et des sols situés en positions planes.
Principaux résultats : les médianes nationales sont à des niveaux plutôt faibles (en mg/kg) : Cd = 0,28 ; Cr = 38,3 ; Cu = 13,3 ; Ni = 19,5 ; Pb = 21,7 ; Zn = 56,4 ; Hg = 0,046. Les teneurs les plus fréquemment supérieures au seuil réglementaire pour l’épandage des boues d’épuration sont celles du nickel (> 50 mg/kg), soit 2,76 % des sites analysés. Des indicateurs statistiques ont été établis pour les 79 départements et 232 régions agricoles de l’INSEE pour lesquels la densité de l’information a été jugée suffisante. Les régions agricoles, quoique recouvrant divers matériaux parentaux et types de sols, sont beaucoup moins hétérogènes aux plans géologiques et pédologiques que les départements.
Un outil de détermination des fonds pédogéochimiques pour la gestion des sites et sols potentiellement pollués
La Base de Données des analyses de Sols Urbains (BDSolU) bancarise des analyses de sols prélevés dans des conditions et selon des protocoles variés, en particulier en milieu urbain. Elle contient aussi la description des lieux de prélèvement, des sondages, des échantillons et des méthodes associés à ces analyses.
Diagnostiquer les sites et sols pollués et gérer les terres excavées
Pour un territoire donné, les concentrations naturelles d’éléments ou de substances persistantes dans le sol, en dehors de tout apport lié aux activités humaines, constituent le « fond pédogéochimique naturel » (FPGN). Le FPGN et les concentrations diffuses dues aux activités humaines constituent le « fond pédogéochimique anthropisé » (FPGA).
Au cours d’un diagnostic de site, la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués recommande de juger la qualité du sol par comparaison aux sols voisins de la zone d’investigation du site et au fond pédogéochimique.
De son côté, la démarche de valorisation des terres excavées au cours des chantiers d’aménagement prévoit de considérer leur cohérence avec le fond géochimique local.
Les valeurs de fonds pédogéochimiques anthropisés sont donc déterminantes dans le cadre de la gestion des sites et sols pollués.
Développement d’un outil de restitution en cours
Toutefois, en milieu urbain, le fond pédogéochimique est fortement anthropisé et mal connu, ce qui justifie le développement de la BDSolU.
Dans un premier temps, celui-ci s’est appuyé, sur le recueil des analyses de sols urbains réalisé à l’échelle nationale par le BRGM pour le compte du ministère en charge de l’environnement dans le cadre des « Diagnostics des sols dans les établissements accueillant des enfants et des adolescents ».
BDSolU est maintenant aussi alimentée grâce aux données recueillies au cours des activités du BRGM et auprès des agglomérations, des collectivités locales et des bureaux d’études souhaitant y contribuer.
Collaboration entre ADEME, BRGM, INRAE, eOde avec l’appui de Mines ParisTech
Une méthode de traitement des résultats d’analyses adaptée aux caractéristiques de ces données et un outil de consultation cartographique interactif sont actuellement en cours de développement. Cet outil repose sur l’’interopérabilité des données BDSolU et Donesol de façon à permettre l’exploitation de plus d’informations et de créer une continuité entre les résultats des zones urbaines, péri-urbaines et rurales.
Ces travaux sont conduits par le BRGM en partenariat avec INRAE, eOde et avec l’appui de Mines ParisTech. Ils s’inscrivent désormais dans le cadre des programmes du GIS SOL.
L’objectif est d’améliorer la connaissance de la qualité des sols, de mettre au point des référentiels et de proposer une plate-forme où les données seront interprétées et restituées aux utilisateurs de la manière la plus automatisée possible. Cette plate-forme sera particulièrement utile aux bureaux d’études, aux aménageurs et aux collectivités en charge des diagnostics de sols et de la gestion des terres excavées. A terme les acteurs urbains du domaine des sites et sols (potentiellement) pollués pourront aussi consulter BDSolU dans le cadre d’autres opérations :
- Etude d’impact ;
- Etat initial pour les sites des ICPE ;
- Détermination de seuils de dépollution ;
- Situation post accident ;
- Gestion sanitaire des lieux de vie.
Lien vers la base de données : http://www.bdsolu.fr/
Placé sous la tutelle des ministres chargés du développement durable et des forêts, l’inventaire forestier national est une des missions de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN). Ce dernier est en effet chargé de l’inventaire permanent des ressources forestières nationales, indépendamment de toute question de propriété (articles L 151-1 à L 151-2 et R 151-1 du Code Forestier).
L’inventaire forestier national figure, depuis 2017, parmi les enquêtes à caractère obligatoire, reconnues d’intérêt général et de qualité statistique (labellisé CNIS). A ce titre, les coordonnées exactes des placettes réalisées relèvent du secret statistique et ne sont pas diffusées librement. Lors de la diffusion des données brutes issues des levés terrain des placettes, ce sont les coordonnées de la maille correspondante qui sont fournies. La placette d’échantillonnage se situe dans un rayon de 700 m maximum autour.
Les placettes de l’inventaire sont considérées comme « semi-permanentes », car elles font l’objet de 2 visites à cinq ans d’intervalle par les opérateurs de l’inventaire, qui possèdent une autorisation spécifique pour entrer sur les propriétés privées forestières. Elles n’ont pas vocation à être visitées ou utilisées par d’autres organismes.
La méthode d’inventaire actuelle
Depuis 2005, l’inventaire forestier national applique une méthode statistique par sondage systématique annuel sur l’ensemble du territoire métropolitain. Elle permet de produire annuellement des résultats nationaux et régionaux précis par agrégation de données issues de cinq campagnes annuelles. L’inventaire forestier repose sur une grille à maille carrée de 1 km de côté, mise en place pour construire dix échantillons annuels différents. Chaque année, un échantillon représentatif de l’ensemble du territoire est constitué en tirant des points au hasard au sein des mailles de l’année considérée.
La première phase statistique de l’inventaire est la photo-interprétation ponctuelle. À partir de l’orthophotographie départementale de référence en infrarouge couleur (BD ORTHO® IRC), des informations relatives à la couverture du sol (couverture boisée fermée ou ouverte, lande, formation herbacée, etc.), à son utilisation (agricole, accueil du public, production de bois, etc.) et à la taille des formations ligneuses sont notées sur des placettes de 25 mètres de rayon entourant les points d’inventaire.
La seconde phase consiste à tirer un sous-échantillon parmi les points de la première phase : seules les couvertures boisées et les landes font l’objet d’un inventaire sur le terrain, soit environ 7 000 points visités chaque année. Ces points font l’objet de levés de terrain complets : des observations et mesures portant sur le milieu et la végétation (arborée ou non) sont effectuées sur les placettes concentriques entourant le point. Cela permet de qualifier plusieurs dizaines de caractéristiques qualitatives et quantitatives, concernant le peuplement forestier, la végétation, les conditions stationnelles (pente, exposition, sol, etc.), les arbres (hauteur, diamètre, accroissement, âge, etc.) et le bois mort au sol.
L’ancienne méthode de l’Inventaire
Depuis la création de la mission d’inventaire forestier national en 1960 et jusqu’en 2004, l’inventaire était réalisé par enquêtes départementales successives et asynchrones, avec une périodicité d’environ 12 ans. Le premier département inventorié, la Gironde, cumule ainsi 4 cycles d’inventaires (1961, 1977, 1987, 1998) et la plupart des autres départements en ont 3 (voire 2). Cette méthode avait été retenue pour assurer une cohérence avec le découpage administratif ; si son taux d’échantillonnage au niveau de chaque département était très élevé, les mises-à-jour étaient éloignées dans le temps et l’obtention de résultats à une échelle supradépartementale limitée du fait du caractère asynchrone des échantillons départementaux. En 1999, les tempêtes Lothar et Martin frappent la France. L’évaluation des volumes de bois touchés met en évidence les limites de cette méthode, les départements affectés ayant, pour certains, été inventoriés plus de 10 ans auparavant. Un changement de méthode est étudié, pour être effectif en 2005.
En ce qui concerne les coordonnées des placettes « ancienne méthode », celles-ci ne relèvent pas du secret statistique. Ce sont donc les coordonnées réelles qui sont diffusées. Noter néanmoins que leur niveau de précision est évalué à + ou – 25 m.
Les données sol
La prise de données pédologiques sur les placettes de l’inventaire forestier national a débuté en 1987 à l’échelon de Nancy. Elle a été étendue en 1992 à l’ensemble du territoire national.
Les premières descriptions pédologiques étaient enregistrées sur un modèle proche de la base DoneSol en cours de création avec description par horizon. Cependant l’inventaire a évolué vers un modèle plus synthétique basé sur la description des horizons par facteurs pédologiques (horizons de texture, d’hydromorphie, de carbonatation, etc.). Deux raisons motivaient cette évolution : en premier pour permettre une exploitation facilitée et une saisie plus rapide, en deuxième pour coller au but recherché qui était une caractérisation des écosystèmes forestiers (typologie des stations forestières) par les grands facteurs pédologiques conditionnant le développement et la croissance des arbres. Cette méthode de description a été décrite par Jabiol B. & Gegout J.-C. (1992) et était amplement utilisée par les auteurs de catalogues des stations forestières.
Le relevé des données sol est réalisé lors de la première visite des placettes. Il est basé sur la description d’une fosse pédologique de 40 cm de profondeur suivi d’un sondage à la tarière jusqu’à une profondeur limite de 1m. Une description de l’humus est également réalisée. Les données détaillées sont consignées sur une fiche de relevé scannée au bureau et les données synthétiques sont insérées dans la base de données après saisie. La saisie des données sur le terrain a débuté en 2008.
La dénomination des types de sol s’appuie sur une clé des sols basée sur la classification CPCS modifiée (Duchaufour P., 1983), les types d’humus sur les prémices de la typologie des formes d’humus (Jabiol B., 1994) reprise dans le Référentiel Pédologique 2008 (AFES, 2008).
Les relevés de terrain ont été effectués par environ 25 équipes ayant reçu une formation pédologique de base, et encadrées par 5 écologues-formateurs vérifiant les données, au bureau et sur le terrain. Des formations continues sont dispensées pour chaque département ou région.
Les données sol de l’inventaire forestier national, ancienne et nouvelle méthode, ont été versées dans DoneSol en décembre 2021 après mise en cohérence avec les tables et les champs de DoneSol. Cela concerne 95 873 relevés pour l’ancienne méthode (période 1987-2004) et 93 043 relevés pour la nouvelle méthode (période 2005-2019).
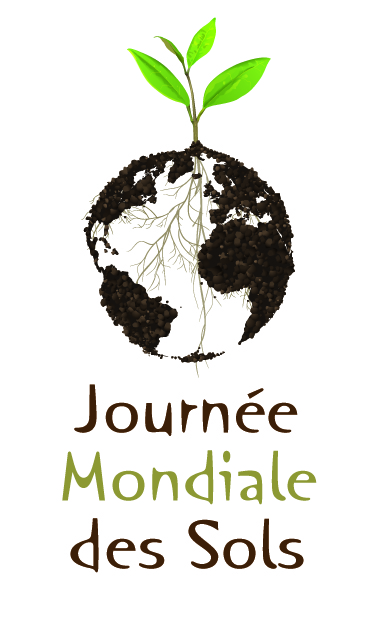 L’Association pour l’Etude des Sols (Afes) organise, du 2 au 7 décembre 2021, différents événements dans le cadre de la Journée mondiale des Sols de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.
L’Association pour l’Etude des Sols (Afes) organise, du 2 au 7 décembre 2021, différents événements dans le cadre de la Journée mondiale des Sols de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.
Le thème de la Journée mondiale des sols 2021 est la salinisation des sols pour comprendre les problématiques de pollution posées par l’accumulation de sels minéraux dans les sols.
L’objectif de ces événements organisés par l’Afes sera plus largement d’explorer les différents phénomènes de dégradation des sols (salinisation, pollutions, érosion, perte de matière organique et de biodiversité,…) et les solutions territoriales susceptibles d’être mise en œuvre pour atténuer ces dégradations. Ce sera également l’occasion d’échanger sur le concept de « santé des sols ».
Le Gis Sol soutient la Journée mondiale des sols.
Les 4 et 5 février 2021 a eu lieu la 5e édition des Rendez-Vous RMQS2.
Cet événement permet chaque année de rassembler les équipes des douze partenaires régionaux de la deuxième campagne du RMQS afin de faire le bilan de l’année écoulée et de préparer la prochaine année RMQS, de permettre aux partenaires RMQS2 d’échanger entre eux et avec l’équipe coordinatrice du projet RMQS d’InfoSol et de présenter les avancées des projets en lien avec le RMQS.
Cette année, malgré les contraintes liées à la pandémie, la campagne d’échantillonnage a pu se poursuivre grâce à l’implication des équipes régionales de terrain, du personnel du Conservatoire européen des échantillons de sols (CEES), des laboratoires d’analyses et de l’équipe projet RMQS2 chargée de coordonner le programme. Les tests de suivi des produits phytosanitaires ont pu se poursuivre et les tests de mesure de la biodiversité du sol ont également pu démarrer.
Pour cette édition particulière des rendez-vous RMQS2, pour la première fois en mode virtuel, plus d’une soixantaine de participants ont répondu présents. Parmi eux, des membres des partenaires régionaux, des membres du Gis Sol, des scientifiques travaillant sur des projets associés au RMQS, l’équipe coordinatrice du projet RMQS et l’équipe du CEES.
Les diaporamas des travaux actuels ou récents en lien avec le RMQS présentés durant ces Rendez-Vous RMQS2 2021 sont listés ci-dessous :
- Introduction, par Dominique Guyonnet, BRGM, Orléans
Etudes de laboratoires analysant les sols du RMQS :
- La qualité microbiologique des sols agricoles, par Samuel Dequiedt, INRAE, UMR Agroécologie, Dijon
- La biochimie environnementale pour l’étude du fonctionnement des sols ; Données RMQS2 2016-2020, par Nathalie Cheviron, Université Paris-Saclay, INRAE, AgroParisTech, UMR ECOSYS, Plateforme Biochem-Env, Versailles
Projets et travaux associés au RMQS :
- RMQS-Biodiversité, par Camille Imbert, INRAE, InfoSol, Orléans
- RMQS et aires protégées, Coralie Serra, INRAE, InfoSol, Orléans
- RMQS-RU, par Maud Seger et Nathalie Curassier, INRAE, UR Sols, Orléans
- RMQS et contaminants, par Claire Froger, INRAE, InfoSol, Orléans
- RMQS et éléments traces émergents en Nouvelle-Aquitaine, par Lionel Savignan, Bordeaux Sciences Agro, Université de Pau et des Pays de l’Adour, Bordeaux
- RMQS et carbone, par Léo Maciotta, GET Observatoire Midi-Pyrénées, INRAE, InfoSol, Orléans